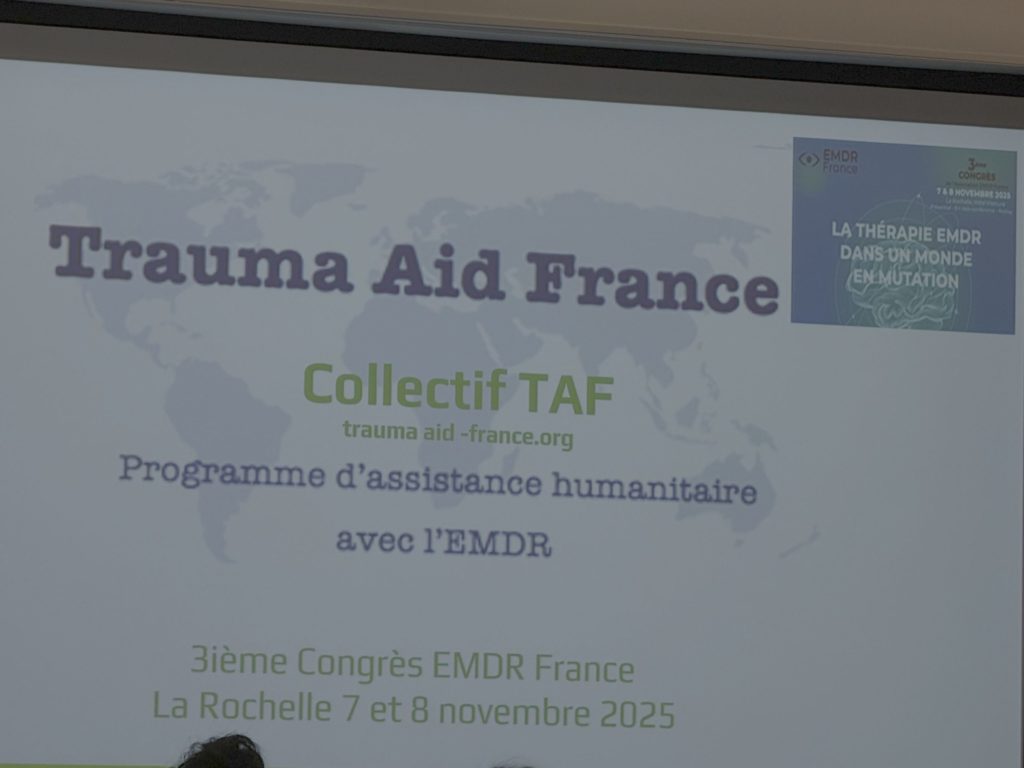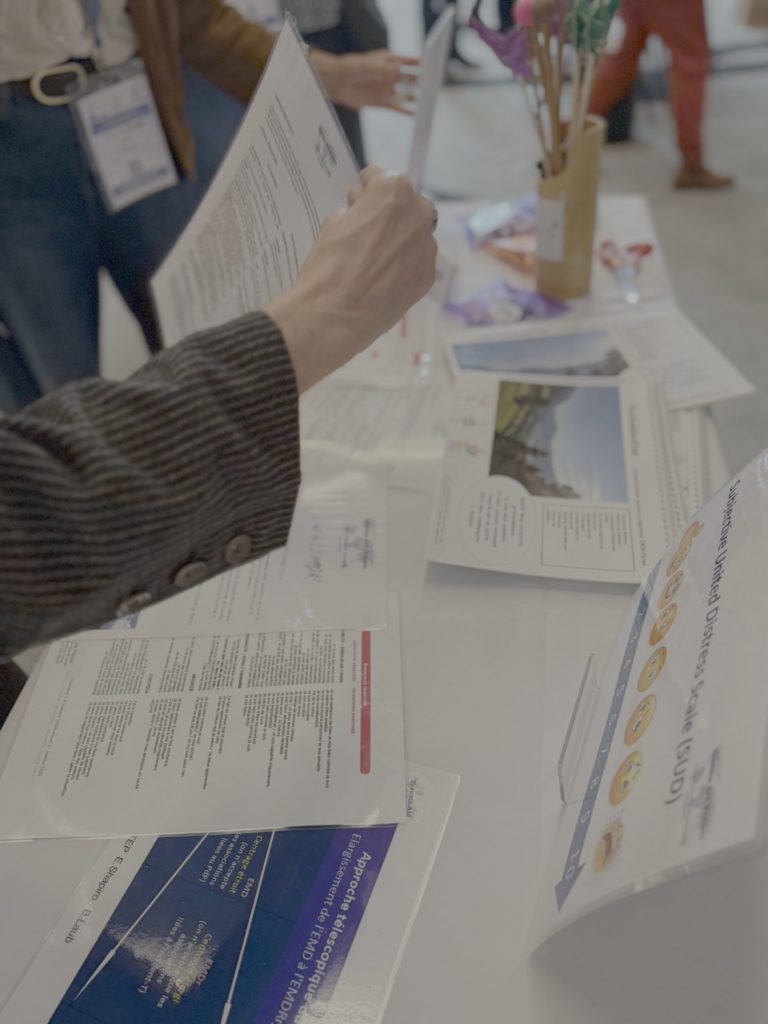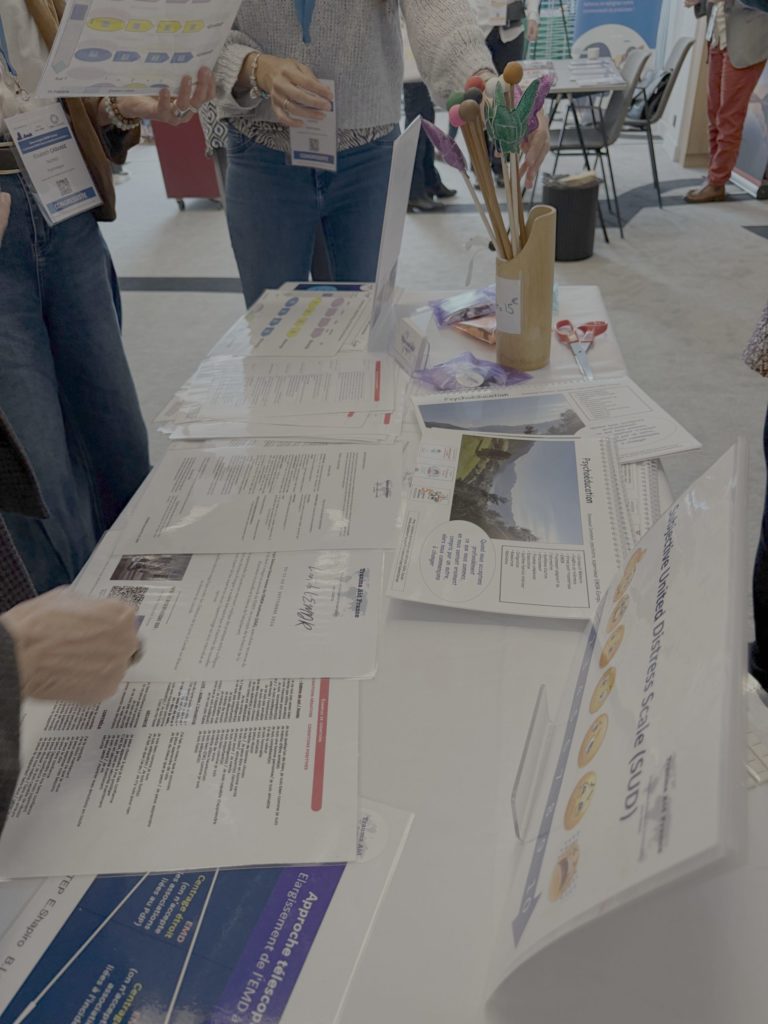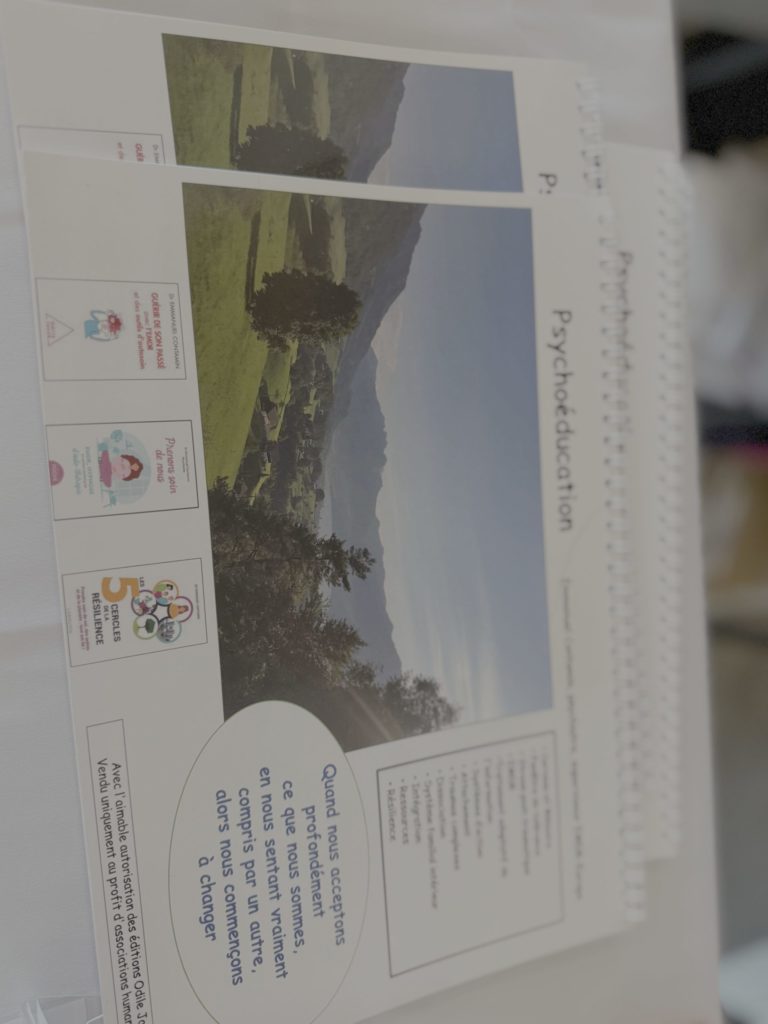Trauma Aid France au Congrès EMDR 2025 : L’EMDR au service de l’humanitaire
Mis à jour le 24 novembre 2025
Une association engagée pour la santé mentale des populations vulnérables
Lors du 3e Congrès EMDR France qui s’est tenu les 7 et 8 novembre 2025 à La Rochelle, Martine Iracane Coste a animé une conférence plénière majeure pour l’association Trauma Aid France, intitulée « L’impact des crises contemporaines sur la santé mentale : le rôle des Associations humanitaires en psychotraumatologie et thérapie EMDR ». Cette présentation, réalisée en collaboration avec Cathy Bonnet, Anne Dewailly, Fanny Guidot et Adeline Pupat, a mis en lumière les actions essentielles de cette association particulièrement active dans le domaine humanitaire.
L’intervention a rappelé l’importance de l’engagement humanitaire dans le domaine de la santé mentale. Dans un monde confronté à des crises de plus en plus fréquentes et complexes, le rôle d’associations comme Trauma Aid France est essentiel pour garantir que les populations les plus vulnérables aient accès à des soins psychotraumatologiques de qualité, fondés sur des approches thérapeutiques validées comme l’EMDR.
Cette présentation inspire et encourage la communauté EMDR à s’engager dans des projets humanitaires, que ce soit par le bénévolat, le partage d’expertise ou le soutien aux actions de Trauma Aid France.
Nous reprenons ici les informations de cette présentation exceptionnelle afin de parler de cette association remarquable et de diffuser au plus grand nombre les projets, les réflexions méthodologiques et les innovations pédagogiques développés autour de cette thématique essentielle qu’est l’EMDR humanitaire en contexte de crises.
L’IFEMDR et Intégrativa accompagnent activement Trauma Aid France dans l’organisation de ses formations humanitaires, notamment par la mise à disposition de supports pédagogiques adaptés. Cette collaboration s’inscrit dans une dynamique de long terme : des participants issus des promotions formées par Trauma Aid France viennent régulièrement poursuivre leur développement professionnel en suivant des formations continues à l’IFEMDR, créant ainsi une continuité dans leur parcours d’apprentissage et de pratique de l’EMDR.
Un contexte mondial qui nécessite une réponse adaptée
Dans un monde en constante mutation, marqué par des crises climatiques et catastrophes naturelles, des défis démographiques, des flux migratoires et de nombreux conflits armés, la santé mentale des populations vulnérables est plus que jamais mise à l’épreuve.
En chiffres
Selon l’OMS, dans une méta-analyse parue dans The Lancet en 2019 :
- 22 % de la population dans les zones affectées par des conflits souffrent de troubles de santé mentale, à tout moment
- 13 % présentent des formes légères (dépression, anxiété, et TSPT)
- 4 % pour les formes modérées (dépression, anxiété, et TSPT)
- 5,1 % pour les formes sévères (dépression, anxiété, TSPT, schizophrénie et troubles bipolaires)
Selon le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), le nombre de personnes en besoin d’assistance humanitaire s’élevait à :
- 325,7 millions en 2022
- 363,3 millions en 2023
- 309 millions en mai 2024
Dans ces contextes complexes, et face à l’émergence de besoins croissants en santé mentale des populations exposées, les associations humanitaires comme Trauma Aid France jouent un rôle crucial dans le parcours de récupération des victimes impactées par l’expérience traumatique. jouent un rôle crucial dans le parcours de récupération des victimes impactées par l’expérience traumatique.
Des constats préoccupants
Les crises entraînent une rupture d’équilibre individuelle, psychosociale, collective et institutionnelle et ont un impact aigu mais aussi et surtout un impact au long cours avec des conséquences chroniques et sévères sur tous les plans.
Dans ces régions, les conditions économiques très précaires rendent la réponse aux crises plus difficiles. Le psychotraumatisme et ses pathologies associées s’inscrivent de manière transversale dans ces contextes pathogènes et délétères au plan de la santé physique et psychologique.
Des conséquences alarmantes
Les crises contemporaines impactent les personnes particulièrement vulnérables : enfants, femmes, personnes âgées ou porteuses de handicaps et les personnes en situation de migration.
- Les crises affaiblissent les moyens d’accès aux soins déjà fort limités surtout en santé mentale. Au sud de Madagascar, le premier hôpital est à 600 km !
- Elles creusent les inégalités mondiales dans la population internationale et renforcent l’isolement des plus faibles
- Les tableaux cliniques sont toujours complexes, réduisant les capacités de résilience face aux stress de la vie
- Elles entraînent des traumas transgénérationnels qui impactent les nouvelles générations et obèrent l’avenir des populations des pays affectés
À noter : Plus de 90 % des financements à l’étranger de l’agence américaine pour le développement international ont été supprimés depuis mars 2025, mettant à mal les ONG.
Les actions de Trauma Aid France : Former pour mieux soigner
La conférence a mis en exergue les initiatives et propositions de Trauma Aid France dédiées aux professionnels de santé, en termes de formations bénévoles à des approches thérapeutiques efficaces où la thérapie EMDR est largement représentée.
Un objectif clair
L’objectif de l’association vise à renforcer les compétences des professionnels et leur fournir des outils adaptés pour accompagner les personnes touchées par des expériences traumatisantes, particulièrement là où les conditions géopolitiques, économiques et sociales de leur pays limitent les moyens d’accès à la formation dans le domaine de la santé mentale.
Les présupposés cliniques de Trauma Aid France
Trauma Aid France est une organisation humanitaire centrée psychotrauma et thérapie EMDR, avec comme principe : « Rompre avec le cercle vicieux de la violence et de la souffrance par le soulagement du traumatisme psychique afin qu’un cycle de guérison individuel et collectif puisse être amorcé » (F. Shapiro).
L’association développe une stratégie de prévention secondaire visant à prévenir :
- Des TSPT-C
- Des dépressions sévères et la mortalité par suicide
- Des effets indirects des traumas : accroissement de la violence intrafamiliale, civile, sociale
- L’occurrence des conduites addictives
- De survenue des symptomatologies physiques et dissociatives associées aux tableaux de TSPT et TSPT-C
Un peu d’histoire : De HAP à TAF
Les programmes EMDR-HAP ont débuté en 1995 en réponse à l’attentat d’Oklahoma City : 168 victimes et 680 blessés. Les secouristes débordés ont fait appel à une prise en charge bénévole par 100 praticiens EMDR.
- Formations gratuites à l’EMDR dispensées à 290 cliniciens locaux pour le relais des prises en charge
- Les résultats sont très positifs : 80 % d’effets bénéfiques en 3 sessions d’EMDR
À partir de là, EMDR-HAP se constitue à travers des programmes menés aux USA et dans plus de 30 pays
2003 : Création du réseau HAP-Europe. Projet humanitaire de formation en Chine, Pologne et Slovaquie
2003 : Création de HAP-France affiliée à HAP-Europe, par Pauline Guillerd, Monika Miravet, Till Van Eersel, Martine Iracane avec le soutien de David Servan-Schreiber
2004 : première mission bénévole en Algérie
2017 : HAP devient Trauma Aid affilié à Trauma Aid Europe puis TAI puis TAE depuis 2024
Des valeurs constantes
- Valeurs humanitaires, humaines et éthiques
- Formations gratuites ou à faible coût, dans les territoires où la formation reste inaccessible : manque de ressources financières, humaines, institutionnelles d’accès aux formations ou sur des terrains de crise majeure
- Respect des identités et des valeurs culturelles des pays destinataires des formations
- Orientation vers l’autonomie et croissance post traumatique des pays : associations, équipes locales, former des praticiens, des superviseurs, des facilitateurs, des formateurs
- Partage de compétences interculturelles pour alimenter une lecture transculturelle du trauma et du modèle TAI
- Respect des étapes de la formation avec un niveau d’exigence élevé tout en s’adaptant au pays
- Pas d’intervention clinique et directe auprès des victimes à priori
- S’adosser aux normes et cadres institutionnels des associations continentales lorsqu’elles existent : EMDR Asia, EMDR Africa, EMDR MENA and Arabic countries
- Respecter l’affiliation à EMDR Global Alliance
- Initier des programmes de recherche, en coopération avec d’autres ONG (ALIMA, Burkina Faso, 2021) et institutions (Hôpital de Panzi, RDC ; Hôpital de CoRSU, Ouganda, 2019)
Les sources de financement des missions
La vente de matériel assurée par Cathy Bonnet sur trauma-aid-france.org
L’art de l’EMDR : une retraite expérientielle didactique pour approfondir ses connaissances, un rendez-vous rituel d’automne à l’ombre des châteaux de la Loire avec R. Solomon et des facilitateurs
En savoir plus : Qu’est ce que L’Art de l’EMDR ? et Matériel pour praticiens EMDR en herbe ou confirmés
Une approche pédagogique adaptée aux contextes de crises
La présentation a interrogé, à travers les enjeux spécifiques et multiples des interventions humanitaires, les dispositifs et les contenus pédagogiques axés sur :
- Le repérage du psychotraumatisme et son traitement
- L’application de techniques de stabilisation
- La conduite de l’enseignement de la thérapie EMDR
Les dimensions prises en compte
Ces formations prennent en compte plusieurs dimensions essentielles :
- L’incidence de la nature des traumatismes collectifs causés par les crises contemporaines
- Le moment de l’intervention (phase aiguë ou post-crise)
- La spécificité des publics de professionnels destinataires
- Les déclinaisons des contenus en fonction des contextes culturels
Où et pourquoi Trauma Aid France intervient ?
Dans les zones du monde fragilisées, de par :
- Le cumul des épisodes macrosociaux politiques et climatiques (Algérie)
- L’ampleur de la catastrophe (Népal, Haïti)
- L’extrême pauvreté du pays (Madagascar, Zimbabwe, RDC)
- Les climats de guerre et de guérillas récurrents menaçant la population (RDC, Zimbabwe)
- Les impacts des crises économiques et politiques, des guerres et conflits communautaires (Zimbabwe, Ouganda, RDC, Roumanie, Tunisie, Cameroun, Rwanda)
- L’existence de camps de déplacés et réfugiés (Ouganda, RDC, Cameroun)
Exemples de missions par contexte
Algérie (depuis 2003)
Contexte – Cumul des épisodes de guerre civile, macrosociaux et climatiques : Les traumatismes psychologiques non réparés (guerre civile, répression populaire, décennie noire, inondations, tremblements de terre) imprègnent les familles et les lignées, générant des troubles psychiques et psychosomatiques sur plusieurs générations.
Référent : Dr Mohamed Chakali, psychiatre, chef de service, qui a créé une consultation en Psychotraumatologie à l’Hôpital psychiatrique Frantz-Fanon de Blida.
Particularités :
- Un climat de guerre civile encore en 2005
- Des soignants traumatisés et marqués par les horreurs des conflits fratricides
- L’association algérienne EMDR Algérie créée en 2016
Interventions et résultats : Des missions annuelles dans plusieurs villes (Alger, Tlemcen, Oran, Constantine, Blida…) avec la consolidation d’un partenariat durable qui permet un travail de tissage de l’EMDR en profondeur dans la culture du pays (Pauline Guillerd, Pascale Amara, Corinne Teulières, Annie Gasse, Martine Iracane Coste).
Présentation détaillée du projet en Algérie
Haïti (2010-2016)
Contexte – L’ampleur de la catastrophe : Séisme de janvier 2010 sans précédent faisant 330 000 morts et 300 000 blessés.
Interventions : N1 en 2010, N2 en 2011. Création d’EMDR Haïti en 2016.
Défis :
- Confrontation aux pertes de repères de sécurité de base
- Chaos / désorganisation sociale
- Épidémies
- Deuils traumatiques
- Confrontation à sa propre mort et à celle d’autrui
Résultats : 26 professionnels formés par Elfrun Magloire avec le soutien de TAF. Coordination à distance par Fanny Guidot, facilitations et supervisions réalisées par Josette Tardy et Annie Gasse. Création d’EMDR Haiti en 2011 sous leur impulsion.
« Ces professionnels formés sont des pionniers de la thérapie EMDR en Haïti. Ils sont très engagés et ont commencé à appliquer la méthode avec les personnes traumatisées dans les hôpitaux et centres d’urgence où ils travaillent »
Présentation détallée du projet en Haïti
Népal (2016-2017)
Contexte – L’ampleur de la catastrophe : Séisme à Katmandou, collaboration avec Action Contre la Faim (ACF), 10 000 morts.
Particularité : L’EMDR est très adapté aux contextes d’urgence car il nécessite peu de matériel, respecte les différences culturelles, et vient en complément de dispositifs de repérage et de techniques de stabilisation élaborées pour les contextes collectifs.
Approche : Renforcer les techniques de stabilisation pour aider au retour dans la fenêtre de tolérance (Thomas Renz et Eva Zimmermann, avec la coordination de TAF : Fanny Guidot et Cathy Bonnet).
Présentation détaillée du projet au Népal (2016-2017)
Madagascar (depuis 2016)
Contexte – L’extrême pauvreté du pays : Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur le taux multidimensionnel de pauvreté des pays en 2024, Madagascar se classe au 5ème rang. 69% de la population malgache n’a pas accès aux services de base pour se soigner, éduquer ses enfants et vivre dans des conditions sanitaires acceptables.
Problématiques :
- Augmentation chez les jeunes des crises psychotiques, de schizophrénie et de dépression
- Anxiété liée aux conditions de vie stressantes provoquées par les crises humanitaires qui sévissent dans le sud de Madagascar
- Place de la sorcellerie
- Peu d’accès aux soins
- Effets du bouleversement climatique : sécheresse, cyclones aggravant la pauvreté et le manque d’accès aux soins
Interventions : Formation N1 et N2 à Antananarivo en 2016 et une promotion 2 en 2023, avec supervisions assurées par Annie Gasse et Martine Iracane.
Particularité : Présence des policiers, juges d’enfants et des affaires familiales, secrétaires le premier jour sur les 2 jours de formation. Puis les travailleurs sociaux, la psychologue, la psychiatre du centre Vonjy avec un public d’Antananarivo pour la formation EMDR. Au total, 50 personnes regroupées en présentiel sur 2 pôles (Majunga et Antananarivo) avec formateur en ligne.
Présentation détaillée du projet à Madagascar (octobre 2022)
Zimbabwe (2014-2017)
Contexte – L’extrême pauvreté du pays + Les climats de guerre et de guérillas récurrents + Les impacts des crises économiques et politiques : Violences organisées et tortures politiques. Conflits entre les acteurs politiques et la société civile. Beaucoup de victimes de tortures. Répressions politiques. Les droits de l’homme sont bafoués. Présence d’ONG comme Amnesty International. Difficultés à accéder aux soins de santé mentale.
Interventions :
- N1 2014, N2 2015 : 24 praticiens formés à la thérapie EMDR N1 (Formateur Gary Quinn, N2 Ludwig Cornil, Facilitateurs Pauline Guillerd et Anne Dewailly)
- 2016 : EMDR Enfants (Niveau 1 enfants avec Michel Silvestre et Anne Dewailly)
Focus enfants : Après avoir ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant en septembre 1990, le Zimbabwe a mis en place de nombreuses mesures pour assurer la protection et la survie des enfants du pays. Même si ces lois ont permis d’améliorer le bien-être de la majorité de ces enfants, les violences intrafamiliales, les violences sexistes, le travail mais aussi le mariage à un très jeune âge sont parmi les dangers auxquels les enfants restent confrontés.
Objectifs formation enfants :
- Renforcer le traitement des traumatismes psychiques chez l’enfant
- Prévenir les troubles de l’attachement
- Réparer les traumas du lien
Présentation détaillée du projet au Zimbabwe (2014-2017)
RDC et Rwanda (2024)
Contexte – L’extrême pauvreté du pays + Les climats de guerre et de guérillas récurrents + Les impacts des crises économiques et politiques +
L’existence de camps de déplacés et réfugiés : Les FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo) affrontent une multitude de groupes armés locaux, dont le M23 (Mouvement du 23 Mars, né en 2012). Le conflit du M23 est une insurrection armée débutée en novembre 2021 dans l’Est de la RDC. Près de 6 millions de déplacés dans l’Est de la RDC en 2023 (IOM, 2023), dont 1 million pour le seul nord Kivu, en raison du conflit avec le groupe armé M23.
Interventions :
- Stabilisation : Adeline Pupat et Fanny Guidot
- EMDR N1 : Formatrice Eva Zimmermann
- Facilitateurs : Fanny Guidot et Thomas Renz
Cameroun (2023-2024)
Contexte – Les impacts des crises économiques et politiques +
L’existence de camps de déplacés et réfugiés : Les facteurs favorisant les problèmes de santé mentale au Cameroun sont multiples. Les violences -toutes formes confondues- mais surtout l’instabilité sociopolitique dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, avec les conflits armés affectant non seulement les populations, mais également les forces de l’ordre. Conditions de vie précaires de manière générale, pauvreté économique. Les statistiques officielles révèlent qu’en 2022, 56,3% de troubles étaient liés à la santé mentale : anxiété, dépression et troubles périnataux. (Dr. Marileine Kemme)
Interventions :
- N1 et N2 assurés en présentiel par Annie Gasse et Martine Iracane Coste
- En distanciel les SPV avec Léonard Ametepe, Fanny Guidot, Annie Gasse
- Sœur Christine Pola : superviseur au Cameroun et en formation de facilitatrice
Cambodge (Phnom Penh) : Mission inter-ONG
Contexte :
- Pauvreté extrême
- Traumas transgénérationnels
- Besoins importants de formation des interlocuteurs de santé mentale de première ligne
Interventions :
- 2011 : Niveau stabilisation (Emmanuel Contamin, Priscilla Buttin)
- 2012 : EMDR N1 (Martine Iracane Coste, Michel Silvestre)
Présentation détaillée du projet au Cambodge
Tunisie (2021)
Contexte – Les impacts des crises économiques et politiques + Crise sanitaire : La révolution des jasmins, les attentats, la crise sanitaire COVID-19.
Particularité : Formation en ligne pour travailler à distance pendant la crise sanitaire. 24 participants tunisiens essentiellement issus du service public.
Équipe pédagogique : Corinne Teulieres, Martine Iracane Coste, Lorenzo Brutti, Leonard Ametepe, Anne Dewally, Fanny Guidot, Nicolas Desbiendras.
Présentation détaillée du projet en Tunisie
Ouganda (2017/18 et 2024)
Contexte – Les impacts des crises économiques et politiques +
L’existence de camps de déplacés et réfugiés : Le trauma ponctue les étapes du parcours migratoire : trauma pré-migratoire, péri-migratoire et post-migratoire. Déplacement et déracinement, stress lié à l’adaptation à un nouvel environnement à la perte de repères fondamentaux de la sécurité de base, de l’attachement à sa terre, aux personnes, aux racines, au transgénérationnel.
Impact sur les réfugiés et déplacés :
- Conditions de vie précaires, promiscuité, camps ou logements temporaires
- Maladies infectieuses
- Problèmes de santé mentale : TSPT, anxiété et dépression (une étude de MSF : jusqu’à 50% des réfugiés peuvent souffrir de TSPT, de dépression ou d’anxiété)
- Violences auto et hétéro-agressives, tendance à la remise en actes (Lancet Psychiatry (2016). « Mental health of migrants: A review. »)
Interventions 2017/18 :
- Une formation générique coordonnée par Anne Dewally sur place et Ludwig Cornil pour la pédagogie
- Une intervention complète pour répondre aux besoins en santé mentale dans le pays
- Une population très jeune en souffrance et la nécessité de former des praticiens EMDR enfants et ados
Présentation détaillée du projet en Ouganda (2018-2020)
L’EMDR au cœur de la démarche humanitaire
La thérapie EMDR et ses aménagements constituent un point central de réflexion au sein de la dynamique de Trauma Aid France, qui se veut ouverte, novatrice mais aussi respectueuse du modèle TAI ayant donné la preuve de son efficacité dans les contextes humanitaires.
Quelques réflexions introductives
Le trauma est universel
« Il y a un caractère universel du psychotrauma, correspondant certainement à l’universalité de l’horreur de notre propre mort » (C. Barrois).
Dans la notion de traumatisme, il existe -quelle que soit la culture- le non-sens de ce qui est vécu.
La symptomatologie, elle, peut prendre des formes différentes en fonction de la culture.
« L’universalité psychique, qui est un postulat de base de l’ethnopsychiatrie et de la psychiatrie transculturelle, concerne le fonctionnement psychique, et pas les symptômes, éminemment variables selon les contextes culturels. » Halima Zeroug-Vial, Psychiatre hospitalier.
C’est la culture dans laquelle on vit qui détermine la manière dont on vit et traite le trauma. C’est dans cette même culture que vont s’inscrire les facteurs de résilience.
La résolution du trauma c’est-à-dire l’intégration traumatique sera d’autant plus probable que le sujet touché donne un sens au traumatisme non seulement par rapport à son vécu singulier mais aussi dans les liens qu’il établit avec les référentiels de sa culture.
Est-ce que la thérapie EMDR née des USA peut s’adapter aux populations appartenant à d’autres cultures ?
« Validée en 2013 pour le traitement du traumatisme psychique par l’OMS, et mise en œuvre dans le monde entier, la thérapie EMDR est également préconisée et présentée comme un traitement culturellement adaptable (Nickerson 2017). »
Ainsi le modèle TAI dans sa fonction de retraitement neuro-émotionnel des mémoires pathogènes et traumatiques pourrait aussi avoir une dimension universelle.
Le TAI réorganise les réseaux de mémoire pour réparer les dégâts du trauma en prenant appui non seulement sur la sécurité et la qualité du lien d’attachement au thérapeute mais aussi sur le sentiment d’appartenance à sa culture.
L’aménagement du protocole standard en Afrique en restant fidèle au modèle TAI
Le protocole standard de la thérapie EMDR peut être aménagé pour y inclure la richesse du savoir des autres mondes.
Les adaptations culturelles du protocole EMDR standard (co-construites par les collègues Africains venant de 5 pays) s’alignent et utilisent ce qui fait sens dans la culture du patient.
Le détail des phases du protocole revisitées par les collègues africains figure dans l’article suivant : Bannink, F., Dewailly, A., Admasu, K., Duagani, Y., Wamala, K., Hazvinei, A.V, Bwesigye, D., Roth, G. (2020) Cultural adaptations of the standard EMDR protocol in 5 African countries. Journal of EMDR Research and Practice, volume 15, number 1, 2021
Phase 1
- Impliquer tous les membres concernés de la famille
- Ne pas s’attendre à des suivis longue durée !
- Utiliser des métaphores culturellement appropriées du modèle TAI. Pas le train par exemple !
- Questionnements culturellement appropriés. Comment on s’adresse aux personnes dans cette communauté
- Ligne du temps visuelle/dans le sable
- Cibler l’urgence et le présent/pas de plan de ciblage complet
- Approche progressive selon la présentation clinique
- EMD/EMDr/EMDR
Phase 2
- Contenant : Une stratégie d’évitement constructif. Proposer différentes images ou de réels contenants, pas uniquement en imagination, ce qui peut être difficile.
- Lieu sûr : La sécurité n’existe pas et le calme peut être activant. Plutôt lieu de bien-être, heureux, spécial. Importance de la dimension collective. Inclure une personne, la famille ou un ancêtre dans ce lieu
- Ressources : Identifier les compétences de survie. Explorer ses ressources familiales, spirituelles, religieuses et culturelles
Phase 3
- Image : Ecriture / Peinture/Danse/Chant/ Dessin
- Les cognitions : « Nous » au lieu du « Je ». On se définit par rapport au collectif. Le trauma n’est pas individuel, il est collectif
- Voc : Vérifier la compréhension de l’échelle/mouvements des mains (du petit au grand)
- Emotions : Psychoéducation / Comment les émotions s’expriment dans votre pays ?
- Sud : Utiliser des couleurs, Dessiner la perturbation
- Sensations : le corporel est particulièrement utile pour les personnes qui ont des difficultés à identifier des croyances et des émotions négatives. Laisser la parole au corps
Phase 4
- Atteinte illusoire d’une phase 4 complète avec un SUD = 0 ou 1 car peu de temps de traitement et nombreuses associations
- Tissage cognitif : Utiliser les croyances religieuses
- « Dirais-tu que ton frère est maudit parce qu’il a fait cela ? »
- « Que dirait Dieu, si tu lui demandais son avis ? » « que je suis béni de Dieu » « qu’il me pardonne etc »
- Attention aux modalités SBA qui doivent être culturellement acceptables
Phase 5
- Installer la CP dans la langue du patient pour plus d’ancrage
Phase 6
- Prudence, le corps peut faire remonter du matériel traumatique non élaboré
Phase 7
- Explorer le système de soutien autour du patient
Phase 8
- Encourager le patient à poursuivre le suivi. Revenir sur la métaphore de la blessure
Innovations pédagogiques, témoignages et réflexion méthodologique
L’équipe de Trauma Aid France a exploré 3 propositions :
- L’approche TSR dédiée aux paraprofessionnels
- Les réflexions / renforcement de l’enseignement N1 et N2
- Proposer des séances EMDR aux partcipants traumatisés en amont et en aval de la formation
L’approche TSR dédiée aux paraprofessionnels
Cette approche est proposée uniquement dans un contexte humanitaire, dans des pays hors Europe.
Le programme TSR : « Traumatic Stress Relief » : Le TSR (Traumatic Stress Relief) est un programme de formation issu du GIST-T (Global Initiative for Stress and Trauma Treatment), élaboré par 25 experts en 2018-2019. Ce programme, basé sur des techniques issues des TCC-CT (Thérapies Cognitivo-Comportementales Centrées sur le Trauma) et du modèle TAI, est proposé uniquement dans un contexte humanitaire, dans des pays hors Europe.
Public : Le TSR s’adresse spécifiquement à deux catégories de professionnels :
- Les paraprofessionnels de santé mentale : personnes formées en santé mentale, mais non « spécialistes » (infirmiers en santé mentale, travailleurs sociaux, etc.)
- Les professionnels « alliés » : professionnels en contact avec les populations traumatisées mais n’ayant pas de formation spécialisée en santé mentale (sages-femmes, médecins généralistes, juristes, enseignants, etc.)
Objectif : Tenter de combler le fossé entre les besoins en santé mentale et la disponibilité de praticiens spécialistes (0,53 pour 100 000).
Exemple concret : En 2019, au Burkina Faso (20 487 979 habitants), on recensait dans les structures publiques : 11 psychiatres, 5 psychologues, 85 infirmières en santé mentale, 10 neurologues. Face à cette pénurie, le TSR permet de former rapidement un plus grand nombre de professionnels capables d’identifier, stabiliser et orienter les personnes traumatisées. Présentation détallée de la collaboration avec Gist-t dans la région des Grands Lacs d’Afrique : le TSR (2019-2020)
Au programme dans la formation TSR (suivie de supervisions)
- Reconnaître le stress traumatique dans la population, expression des signes dans la culture
- Modèle explicatif du Trauma, cerveau triunique de Mc Lean et introduction au TAI
- Techniques d’ancrage +++
- Stabilisation +++ (lieu calme, 4 éléments, set d’exercices d’auto-apaisement : respiration abdominale, concentration et visualisation d’un bon souvenir)
- Communication empathique
- Élaboration en groupe des modalités de mise en œuvre, quand faire quoi
- Protocole de groupe adapté (Worksheet), issu du GTEP : pratiques pendant et après la formation entre apprenants, avec supervision, puis, une fois qu’ils sont prêts, les personnels formés peuvent offrir des sessions avec leur public
- Avec des supervisions proches de la date des premiers groupes, puis mensuellement, avec contact pour soutien à la demande
Retour d’expérience et utilisation :
- La stabilisation occupe une grande place (par psychoéducation, communication empathique, ancrage et exercices de stabilisation).
- Les paraprofessionnels de Santé Mentale utilisent les techniques apprises, dont le protocole Worksheet, en complément de leurs activités habituelles.
- Les professionnels alliés identifient mieux les personnes traumatisées, les aident à s’ancrer et les orientent vers les paraprofessionnels formés.
- Les cas sévères sont référés quand cela est possible ou accompagnés sous supervision du spécialiste référent aussi formé au TSR.
Résultats : Auprès des publics de personnes déplacées internes (N=92), l’étude exploratoire suggère une amélioration des scores de résilience (BRS – Brief Resilience Scale, Smith 2008) et de trauma (ITQ – International Trauma Questionary, Cloitre et al., 2018).
(Limites : pas de groupe contrôle, et traduction ad hoc des instruments, non validée)
Les réflexions / renforcement de l’enseignement N1 et N2
Réflexions sur les modulations de l’enseignement : un double objectif
- 1 – Travailler en amont avec la fonction groupale avec les partcipants avant le N1
- 2 – Favoriser un apprentissage applicable de manière réaliste et appropriée pour les suivis de leurs patients
Travailler en amont avec la fonction groupale avec les participants avant le N1
- Les participants sont souvent très impactés.
- Choix du protocole de groupe : ASSYST, GTEP, IGTP ? L’Assyst protocole en EMDR (The ASSYST – Acute Stress Syndrome Stabilization, Dr. Ignacio Jarero) en individuel ou en groupe.
- Phase 2 renforcée : avant l’apprentissage du retraitement des cibles, donner beaucoup de techniques de régulation émotionnelle incorporant des techniques d’ancrage et de gestion des abréactions, des techniques de contenance, des techniques de distanciation, des techniques de contrôle, des techniques d’apaisement
- Objectifs : Pour favoriser l’apprentissage du modèle TAI au N1 qui réclame beaucoup de concentration. Renforcer ces dimensions pour le travail en visio / fenêtre de tolérance moins bien contenue
Favoriser un apprentissage applicable de manière réaliste et appropriée pour les suivis de leurs patients
- Le groupe est inscrit dans le fonctionnement culturel de nombreux continents
- Le travail en EMDR de groupe est nécessaire compte tenu de la pauvreté des moyens médico-psychologiques pour traiter une patientèle de plus en plus nombreuse et de plus en plus en souffrance psychique et post-traumatique
Adaptation des contenus de formation du niveau 1
Réflexion du groupe TAF issue des interventions récentes au Rwanda pour les participants Rwandais et de RDC qui conduit à envisager dans des contextes similaires des propositions/adaptation pour le niveau 1 mais qui respecteraient le modèle TAI et le protocole standard :
- La recherche du souvenir source du passé lointain n’est pas toujours adaptée
- Le plan de ciblage en 3 temps peut être construit sur la modalité réduction de symptômes. Sinon : Perte de la qualité d’accordage et risque d’hyperactivation ou dissociations des patients trop envahis déjà par des événements récents. Dans leur pratique, les thérapeutes ne voient souvent leur patient qu’une ou deux fois !
- Les événements récents constituent les cibles prioritaires : Centrage premier afin de réduire la symptomatologie bruyante et renforcer compétence et conduites adaptatives
- Associer à l’apprentissage du protocole standard l’apprentissage précoce du traitement télescopique EMD EMDr (EMDR) et protocoles ER : REP (F. Shapiro) RTEP (E. Shapiro) pour plus de sécurité et d’efficacité dans le traitement pour patient et thérapeute
Adaptation des contenus de formation du niveau 2 – Réflexion méthodologique
Dans les contextes de crise géopolitique et contexte sécuritaire défaillant, nécessité de réfléchir :
- À l’adaptation de N2 format distanciel si présentiel impossible
- À une formation moins dense pour respecter le temps d’intégration/contexte traumatique++ (étaler sur 4 à 6 semaines ?)
- À des modalités de transmission plus ajustées et nuancées :
- Des modules courts d’enseignement théorique par capsules sur les différents contenus de l’apprentissage
- Associant objectifs cliniques et démonstration des phases et des protocoles (EMD, DIR, Eponge, CIPOS etc.) exemples cliniques (en direct et en vidéo de cas de traitement)
- Des temps de facilitation courts en direct pour un accompagnement qualitatif et dense en ajustant la fréquence des plages de facilitation
Synthèse des actions pédagogiques adaptées
Les participants professionnels de santé mentale dans leur pays sont à l’interface entre la population en souffrance et notre équipe missionnée vers le pays destinataire des formations.
Réfléchir à l’enseignement de l’EMDR pour nos participants pour faciliter l’intégration compte tenu de leur niveau de trauma vicariant et traumas directs participe à l’apprentissage de la transmission d’un modèle sécure et source de résilience pour les patients.
- Développer la psychoéducation : en lien avec les représentations de la culture pour faire sens
- Renforcer la stabilisation dans les contextes aigus ou chroniques avec TSPT-C : essentiel pour les professionnels que nous formons et donc pour leurs patients
- Rajouter des ressources externes (le groupe) et spirituelles : s’adresser aux ancêtres/protection, aux croyances étayantes est l’occasion de renforcer des réseaux adaptatifs qui s’inscrivent profondément dans le sens du collectif de la culture et du transgénérationnel
- Aider à développer les approches groupales : invariant de la culture africaine
- Moduler les contenus de formation sur des timings différents
- Adapter le protocole standard en fonction de la culture
- Travailler les approches EMDR événements récents individuelles et groupales
- Encourager les participants à travailler en groupe sur la traduction de protocoles dans la langue locale ou le dialecte
Défis pour la formation EMDR
1. L’évaluation des besoins
- Potentialiser les réseaux existants : les associations EMDR existantes au niveau pays ou région, associations humanitaires
- Prendre appui sur les ressources locales et culturelles institutionnelles individuelles
- Conduire des interventions construites au cas par cas après analyse des besoins, du manquant, de l’existant
- En prévision des formations incluant repérage, stabilisation, traitement du trauma, formation EMDR et supervision clinique
2. La sélection des participants
Critères à vérifier :
- Que les participants sont aux contacts avec les futurs bénéficiaires
- Les contraintes géographiques
- Les critères de sélection des participants
- Large éventail de niveaux de connaissance et de compétences entre les participants
- Participants aussi traumatisés
- Modifications des pré-requis
3. Les contraintes sécuritaires
Pour les participants :
- Éviter les horaires tardifs de fin de séance
- Temps de trajet compliqués et dangereux si les participants ne sont pas logés sur le site en résidentiel
- Les femmes doivent être au foyer aux heures des regroupements familiaux
Pour l’équipe : augmentation des risques la nuit
Pour le dispositif de la formation :
- Algérie : risques attentats → transfert de la formation à Aix-en-Provence
- Grands Lacs : participants Congolais et Rwandais : RDC → Rwanda, Kigali
Exemple en Algérie, 2009 : Déplacement de la formation à Aix-en-Provence suite au contexte sécuritaire (attentats) après 2 reports. Accueil au CHS Montperrin. Hébergement dans les réseaux de soignants et d’amis. Prise en charge financière des repas et des salles par le Directeur J. François. Bel exemple de rencontres interculturelles.
4. Un cadre de formation à adapter
La notion de temps :
- La présence des jeunes enfants pendant la formation
- La flexibilité par rapport à la ponctualité : le rapport au temps (il est extensible !) peut être différent comparé aux contextes occidentaux
Les pauses : permettre l’accès et le temps à l’espace de méditation collective au Cambodge
S’adapter à la culture du pays :
- S’autoriser à faciliter un bébé dans les bras…
- Accepter que les mères allaitent leur bébé pendant la présentation théorique
- La transmission intergénérationnelle des ressources et la sensibilisation précoce à la thérapie EMDR !
5. Le contenu des formations
- Renforcer la psycho-éducation du psychotrauma à l’attention des professionnels : Dénominateur commun des pays du sud et émergeants. Pays sous-dotés de professionnels en santé mentale. À Madagascar, 24 psychiatres à la SMP pour 32 740 678 d’habitants. Peu de données en santé mentale dans les cursus de formation
- Renforcer la psycho-éducation du psychotrauma en fonction des référentiels culturels. Exemple : Dr J. Andria, une fable pour expliquer le traumatisme présenté en introduction et en langue malgache. En intégrant de manière interactive les participants
- Renforcer les techniques de stabilisation et les ressources en fonction de la culture. Exemple : ressources spirituelles, en lien avec l’esprit des ancêtres, en fonction des mythes et des croyances
- Intégrer un public large de professionnels pour aider au repérage à l’orientation des soins. Exemple : formation public pluridisciplinaire
- Tenir compte du niveau d’impact traumatique des participants eux-mêmes
Exemple à Madagascar, en 2022 : Repérer, accompagner, orienter les mineurs marqués par l’expérience traumatique consécutive aux violences sexuelles
- Équipe des professionnels du Centre VONJY de Majunga
- Psychologues et psychiatres se préparant à la formation EMDR Antananarivo
- 50 personnes regroupées en présentiel sur 2 pôles Majunga et Antananarivo ; formateur en ligne
- Présence des policiers, juge d’enfants et des affaires familiales, les secrétaires premier jour sur les 2 jours de formation. Puis les travailleurs sociaux, la psychologue, la psychiatre du centre Vonjy avec un public d’Antananarivo pour la formation EMDR.
6. Le suivi des actions et l’organisation des supervisions
- Temps de supervisions plus renforcés
- On privilégie l’expérientiel pour intégrer le protocole
- Les supervisions mettent en évidence la richesse des différences dans les représentations liées à la culture
- Tenir compte du risque de trauma vicariant chez les intervenants européens
En conclusion
La thérapie EMDR peut être utilisée dans des contextes de grande précarité sociale ou d’extrême urgence.
Elle nous permet de rester fidèles au protocole de Francine Shapiro en 3 temps et 8 phases pour les bénéficiaires tout en s’adaptant à la sévérité des tableaux nosographiques.
Sous réserve de quelques aménagements, elle peut être transmise dans des cultures différentes.
Il est souhaitable :
- De renforcer les réseaux d’intervention et la formation continue en psychotraumatologie pour répondre aux besoins croissants dans les années à venir
- D’impulser des approches innovantes (thérapies collectives communautaires, supervisions en ligne, échanges interculturels)
La crise étant une opportunité de changement, alors une intervention TAF devient le catalyseur d’une croissance post-traumatique et la création de réseaux de mémoire adaptatifs pour tous les protagonistes de la rencontre interculturelle.